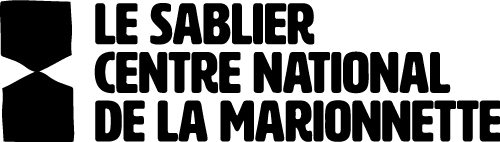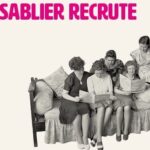entre corps, image et objet
La saison
La saison
Tous les spectacles
Prochain spectacle
visite de chantier - Matin et soir
mer. 17 Avr. à 19:00